CULTURE
Actus - Débats
Will Eisner contre la théorie du complot
 Will Eisner sur le forum E. Leclerc, Angoulême 1993 - Crédit photo : J. Bibard
Dans la bande dessinée, il n’y a pas que des histoires de petits Mickey. Il existe aussi de géniaux artistes pour transformer les arts de la bulle en un implacable réquisitoire contre ce que la bêtise humaine a su produire de plus dangereux : la rumeur !
Les éditions Grasset viennent de publier la traduction française du dernier ouvrage de Will Eisner : « Le complot » (préfacé par Umberto Ecco). Un livre testament à mettre dans toutes les mains ! L’histoire et le décryptage d’une des plus grandes manipulations du siècle précédent, dont les Juifs furent les victimes exclusives.
Will Eisner sur le forum E. Leclerc, Angoulême 1993 - Crédit photo : J. Bibard
Dans la bande dessinée, il n’y a pas que des histoires de petits Mickey. Il existe aussi de géniaux artistes pour transformer les arts de la bulle en un implacable réquisitoire contre ce que la bêtise humaine a su produire de plus dangereux : la rumeur !
Les éditions Grasset viennent de publier la traduction française du dernier ouvrage de Will Eisner : « Le complot » (préfacé par Umberto Ecco). Un livre testament à mettre dans toutes les mains ! L’histoire et le décryptage d’une des plus grandes manipulations du siècle précédent, dont les Juifs furent les victimes exclusives.
 Ce n’est certainement pas un hasard dans la stratégie de l’éditeur. En 1921, Grasset avait, après et comme tant d’autres, publié un infâme brûlot « Les Protocoles des Sages de Sion ». Le temps est passé, a produit ses ravages, mais le subterfuge fut dénoncé. Grasset, non sans élégance, se rachète en publiant la démonstration du complot à laquelle s’est attelé Will Eisner, juste avant de tirer sa révérence et de rejoindre « The Spirit » dans l’immortalité.
Pour beaucoup d’adolescents américains, Will Eisner est d’abord l’un des grands maîtres du comics. Il a créé « The Spirit » qu’il a dessiné de 1940 à 1953. Son héros (Denny Colt) est un détective, un criminologue qui s’est mis en tête de faire respecter la loi. Pas de transformation en Spiderman ou autre Batman. Avec « un petit loup de velours » sur les yeux, il arpente Central City à New York, enquête aux côtés du commissaire Dolan, un pote franchement soupe au lait. Mais dont la belle Hellen, sa fille, justifie qu’on prenne patience aux côtés du grincheux. Du polar, donc, sans la violence de F. Miller, mais avec ses malfrats, la misère des quartiers de briques, et son théâtre d’ombres.
« The Spirit » a valu à Will Eisner une renommée internationale. Mobilisé pendant la guerre, Will a su déléguer, travailler en studio et confier l’écriture et le dessin à quelques autres dessinateurs amis. Et le succès aidant, c’est toute une nouvelle génération qui, jusqu’aux années 1998-1999, revendiquait l’influence du Spirit, lui-même dans la lignée des dessins de Milton Caniff, d’Alex Raymond ou de George Herriman.
Mais cet homme affable, doux, attentif (nous l’avons beaucoup apprécié lors de ses courts passages au Festival de la BD d’Angoulême) ne s’est jamais laissé enfermer dans un genre littéraire. Quand d’autres recopiaient les maîtres, lui innovait avec le théâtre, mais surtout le « roman graphique ». Voilà qui nous valut « Un pacte avec Dieu », « Fagin le Juif » (un focus sur l’un des personnages secondaires d’Oliver Twist de Dickens).
Mais comme Art Spiegelman dont l’interrogation sur les camps de concentration nous valut « Maus », ce sommet du 9ème art, Will Eisner n’a jamais oublié son enfance dans une famille d’immigrés juifs aux Etats-Unis. Les tensions raciales après la crise de 1929, le communautarisme juif à New York, la Shoah, l’exploitation de l’antisémitisme dans le monde islamique ou, plus près de lui, par les fachos du Ku Klux Klan…l’ont conduit à mener l’enquête sur cette formidable manipulation que constitue l’histoire des Protocoles.
Ce n’est certainement pas un hasard dans la stratégie de l’éditeur. En 1921, Grasset avait, après et comme tant d’autres, publié un infâme brûlot « Les Protocoles des Sages de Sion ». Le temps est passé, a produit ses ravages, mais le subterfuge fut dénoncé. Grasset, non sans élégance, se rachète en publiant la démonstration du complot à laquelle s’est attelé Will Eisner, juste avant de tirer sa révérence et de rejoindre « The Spirit » dans l’immortalité.
Pour beaucoup d’adolescents américains, Will Eisner est d’abord l’un des grands maîtres du comics. Il a créé « The Spirit » qu’il a dessiné de 1940 à 1953. Son héros (Denny Colt) est un détective, un criminologue qui s’est mis en tête de faire respecter la loi. Pas de transformation en Spiderman ou autre Batman. Avec « un petit loup de velours » sur les yeux, il arpente Central City à New York, enquête aux côtés du commissaire Dolan, un pote franchement soupe au lait. Mais dont la belle Hellen, sa fille, justifie qu’on prenne patience aux côtés du grincheux. Du polar, donc, sans la violence de F. Miller, mais avec ses malfrats, la misère des quartiers de briques, et son théâtre d’ombres.
« The Spirit » a valu à Will Eisner une renommée internationale. Mobilisé pendant la guerre, Will a su déléguer, travailler en studio et confier l’écriture et le dessin à quelques autres dessinateurs amis. Et le succès aidant, c’est toute une nouvelle génération qui, jusqu’aux années 1998-1999, revendiquait l’influence du Spirit, lui-même dans la lignée des dessins de Milton Caniff, d’Alex Raymond ou de George Herriman.
Mais cet homme affable, doux, attentif (nous l’avons beaucoup apprécié lors de ses courts passages au Festival de la BD d’Angoulême) ne s’est jamais laissé enfermer dans un genre littéraire. Quand d’autres recopiaient les maîtres, lui innovait avec le théâtre, mais surtout le « roman graphique ». Voilà qui nous valut « Un pacte avec Dieu », « Fagin le Juif » (un focus sur l’un des personnages secondaires d’Oliver Twist de Dickens).
Mais comme Art Spiegelman dont l’interrogation sur les camps de concentration nous valut « Maus », ce sommet du 9ème art, Will Eisner n’a jamais oublié son enfance dans une famille d’immigrés juifs aux Etats-Unis. Les tensions raciales après la crise de 1929, le communautarisme juif à New York, la Shoah, l’exploitation de l’antisémitisme dans le monde islamique ou, plus près de lui, par les fachos du Ku Klux Klan…l’ont conduit à mener l’enquête sur cette formidable manipulation que constitue l’histoire des Protocoles.
 Pour ceux que les détails intéressent, l’éditeur Berg International a publié deux études de Pierre-André Taguieff sur le sujet. C’est sous Napoléon III que l’histoire diabolique commence. Pour expliquer la défaite et la débâcle, on ne se contente pas de dénoncer le traditionnel bouc émissaire juif. (A l’époque, les Juifs sont intégrés, ils sont français, allemands, de religion juive, ils sont banquiers, ingénieurs, artistes ou médecins). Oui, justement, « ils sont partout » (et non plus dans les ghettos ou les quartiers dont l’exclusion remontait au Moyen-Age)… De là à donner à penser qu’il s’agit d’une stratégie délibérée pour pénétrer tous les mouvements d’idées comme les différents échelons de la vie politique, voilà qui va alimenter la thèse du complot.
Dreyfus innocenté, l’antisémitisme redouble (à droite et à gauche ! ! !). C’est la révolution russe de 1917 qui réactualise la thèse. La monarchie russe déchue voit « la juiverie internationale » derrière les mouvements d’insurrection. Même référence utilisée par les idéologues du 3ème Reich qui pointent dans le Traité de Versailles et le coût des réparations « un coup de poignard dans le dos »…
Will Eisner raconte l’origine de la thèse, sa réécriture, les ambiguïtés savamment entretenues qui permettent à la rumeur de renaître de ses cendres lors de chaque crise sociale.
Superbe travail. Moins d’émotion que chez Spiegelman. L’auteur a surtout misé sur la pédagogie. Quand on sait que les Protocoles des Sages de Sion continuent de circuler sur internet, il faut une bonne dose d’optimisme et de confiance dans l’espèce humaine pour aborder « la Chose » avec humour et ironie plutôt qu’en y mettant le feu. C’est ça…Will Eisner.
Pour ceux que les détails intéressent, l’éditeur Berg International a publié deux études de Pierre-André Taguieff sur le sujet. C’est sous Napoléon III que l’histoire diabolique commence. Pour expliquer la défaite et la débâcle, on ne se contente pas de dénoncer le traditionnel bouc émissaire juif. (A l’époque, les Juifs sont intégrés, ils sont français, allemands, de religion juive, ils sont banquiers, ingénieurs, artistes ou médecins). Oui, justement, « ils sont partout » (et non plus dans les ghettos ou les quartiers dont l’exclusion remontait au Moyen-Age)… De là à donner à penser qu’il s’agit d’une stratégie délibérée pour pénétrer tous les mouvements d’idées comme les différents échelons de la vie politique, voilà qui va alimenter la thèse du complot.
Dreyfus innocenté, l’antisémitisme redouble (à droite et à gauche ! ! !). C’est la révolution russe de 1917 qui réactualise la thèse. La monarchie russe déchue voit « la juiverie internationale » derrière les mouvements d’insurrection. Même référence utilisée par les idéologues du 3ème Reich qui pointent dans le Traité de Versailles et le coût des réparations « un coup de poignard dans le dos »…
Will Eisner raconte l’origine de la thèse, sa réécriture, les ambiguïtés savamment entretenues qui permettent à la rumeur de renaître de ses cendres lors de chaque crise sociale.
Superbe travail. Moins d’émotion que chez Spiegelman. L’auteur a surtout misé sur la pédagogie. Quand on sait que les Protocoles des Sages de Sion continuent de circuler sur internet, il faut une bonne dose d’optimisme et de confiance dans l’espèce humaine pour aborder « la Chose » avec humour et ironie plutôt qu’en y mettant le feu. C’est ça…Will Eisner.
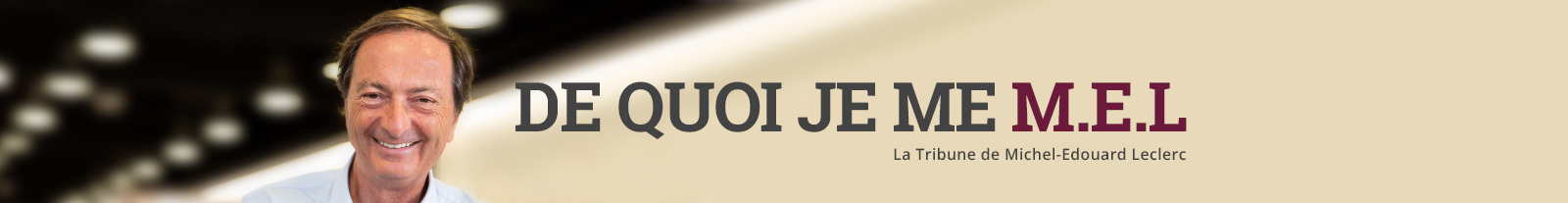





3 Commentaires
Vous parlez dans votre chronique de "ghettos ou les quartiers dont l’exclusion remontait au Moyen-Age".
Certes, mais laissez moi vous narrer que ma charmante voisine, que j'aime (d'amitié s'entend) et dont le fils vient souvent jouer avec mes fils, souhaite aller s'installer à Vincennes car il y a une forte communauté juive et il serait donc plus facile pour elle d'obtenir des aliments cacher et donc de suivre tous les préceptes de la loi de Moïse.
Effectivement quand on se ballade à Vincennes ou à Paris, rue des boulets près de nation, force est de constater à la lecture des enseignes qu'il y a une forte concentration d'habitants juifs.
Alors qui exclut qui ? Comment se forment les ghettos ? Il me semble qu'il y a là une vraie question...non ?
Vous avez raison. Mues par un souci ancestral de sécurité, de proximité ou de communautarisme, les minorités cherchent souvent à se regrouper alors que, paradoxalement, elles tiennent un discours intégrationniste. Toutes les grandes villes ont plus ou moins leurs quartiers juif, chinois, italien…façonnés au gré des courants migratoires et des rapports quelquefois houleux avec les populations locales.
Mais il ne faut pas confondre les politiques de confinement dont ces communautés ont souffert, et les regroupements volontaires à l’instar du comportement de votre voisine. Evidemment, les populations ne vivent pas ces pratiques urbaines de la même manière selon qu’elles sont librement consenties ou contraintes.
En revanche, votre remarque est pertinente. Pour libres de se regrouper que soient ces minorités dans nos démocraties, elles finissent, à leur tour, par créer un sentiment d’exclusion de la part des individus qui n’en font pas partie. Etre citoyen blanc dans le Bronx fut longtemps une gageure ! Et la clientèle de Le Pen se recrute désormais facilement dans les populations « petits blancs » qui se sentent chez eux, envahis par les pratiques culturelles festives et quelquefois religieusement ostentatoires des familles environnantes.
Au fond, d’anciens exclus peuvent finir aussi par exclure…
100% d'accord avec vous.
Je crois justement que le coté irrationnel de l'antisémitisme et de tout racisme en général provient du fait qu'il est quasi impossible de trancher nettement entre volonté de regroupement endogène à la communauté et les politiques de confinement qui lui sont exogènes (mises à part lors des périodes sombres de l'histoire telles le nazisme).
L'un d'ailleurs nourrissant l'autre et inversement dans un mouvement circulaire pluri-séculaire. Et je trouve dommage que lorsque l'on traite ces questions on ne prenne pas en compte plus fortement ces mouvements sous prétexte que celà ferait verser la politique d'intégration dans le communautarisme.
Si on prend l'exemple des banlieues à forte population immigrée, on ne dispose d'aucune étude tendant à identifier quel % d'immigré sont venus y habiter car ayant, à leur arrivée en France des cousins, amis qui y résidaient et pouvaient donc les aider dans leurs démarches administratives initiales et à quel % l'administration a imposé le lieu de résidence.