Conseil d’Etat, Autorité de la Concurrence : plus jésuite, tu meurs !
1. C’est évidemment ce que nous voulions entendre dire et confirmer : la décision du Conseil d’Etat reprécise l’absence de portée impérative d’une injonction émise dans le cadre d’un Avis de l’ADLC. Il n’y a donc plus d’obligation, ni d’urgence pour que les groupements d’indépendants se plient à l’ardente obligation de se transformer en « auberges espagnoles ». (On nous demandait d’organiser la mobilité des affiliés entre les enseignes en limitant leur contrat d’adhésion à sept ans !!!)
2. Mais si le Conseil d’Etat est logique avec lui-même en déclarant, de ce fait, irrecevables les demandes d’ITM et de E. Leclerc qui s’estimaient visés, il ne clarifie cependant pas les moyens par lesquels des opérateurs économiques pourraient émettre une critique, une analyse opposée ou même faire valoir leurs droits, avant que l’ADLC n’émette un avis les concernant. Et qu’elle saisisse le législateur à partir du seul Avis émis par elle.
Personne ne peut contester ce fait : paré du prestige de l’ADLC, un avis, même « ramené au rang d’avis », exerce une influence énorme auprès du Parlement et des gouvernants. Sans autre procédure garantissant une forme « de contradictoire », il n’est pas facile pour n’importe quel industriel ou commerçant de faire valoir son point de vue. Que pèsent les propos d’un industriel lors d’une hypothétique Audition en Commission Parlementaire face à un Avis opposé de l’ADLC ? Les groupements d’indépendants (E. Leclerc, Système U, Intermarché) en ont fait l’amer constat à l’occasion du débat sur la loi Lefebvre, laquelle se contentait de se référer à l’Avis de l’ADLC sans autre forme d’enquête économique sérieuse, d’analyse d’impacts, etc… Il a fallu rameuter et convaincre les meilleurs spécialistes du Droit de la Concurrence, dans les rangs de la Droite comme de la Gauche, pour obtenir qu’on rectifie le tir et qu’on ne saborde le statut des coopératives de commerçants. La décision du Conseil d’Etat n’épuise donc pas la question des procédures contradictoires avant que l’Autorité ne saisisse le législateur. Je faisais référence aux jésuites. On nous dit que, lorsqu’il émet un Avis, le Conseiller ne peut se prévaloir d’un droit de décision. Mais quand le Parlement légifère en se référant à l’unique Avis du Conseiller, qui, selon vous, détient le vrai pouvoir, si ce n’est le Conseiller ? CQFD.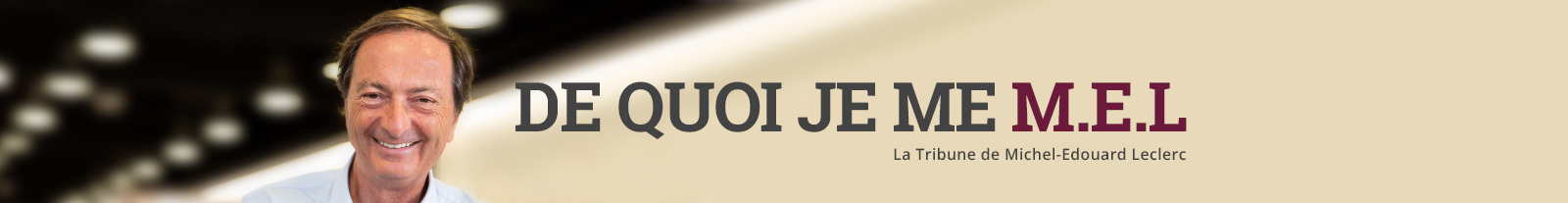


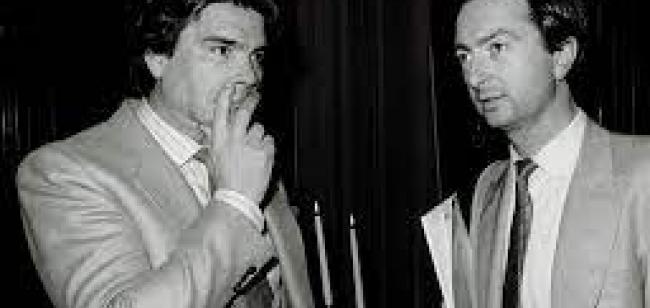


10 Commentaires
Voilà un éclaircissement sur le fonctionnement de nos institutions.
Avez vous rencontré des difficultés de ce type dans d'autres pays ou cela caractérise-t-il l'exception culturelle française?
Que pensez vous de cette affirmation?
"Il faut étendre les pouvoirs
du Conseil Constitutionnel
En instituant le Conseil constitutionnel, le Général de Gaulle a inclus une disposition nouvelle. Tout laisse à penser qu'il a calqué cette idée sur la Constitution américaine.
Des perfectionnements y ont été apportés. C'est ainsi que sa saisine, qui était, au départ, réservée uniquement au Président de la République et aux Présidents des deux Assemblées, a été étendue aux parlementaires pour autant que cinquante d'entre eux le demandent.
Comme aux États-Unis, le Conseil constitutionnel est dépendant, pour une large part, du pouvoir puisque ses membres sont nommés par les Présidents de la République et des deux Assemblées. Nous avons constaté que ce mode de désignation ne présentait pas jusqu'à ce jour d'inconvénients majeurs en raison même de ce que les membres choisis pour siéger ont, pour la plupart, une compétence juridique incontestable.
Or, le Conseil constitutionnel ne peut intervenir que dans les cas limités, c'est-à-dire lorsqu'il est saisi avant la promulgation d'une loi votée par le Parlement.
Le droit français comporte malheureusement une foule de dispositions qui ne sont pas conformes à la Constitution. Toutes ces lois sont appliquées et personne ne peut invoquer leur nullité. Si l'on se réfère aux États-Unis, où la Cour suprême fait office de Conseil constitutionnel, l'on remarque que cet organisme est habilité à régler les différends opposant les citoyens à l'État fédéral.
Il importe que le Conseil constitutionnel puisse intervenir en pareil cas car il est intolérable qu'en l'absence d'une juridiction compétente, les citoyens soient victimes de dispositions anticonstitutionnelles.
Cette réforme ne nécessite pas d'importants changements juridiques mais elle s'impose dans un pays de droit dont la règle démocratique constitue la base même des rapports entre les citoyens et l'État.
Chaque jour des sentences sont rendues par les tribunaux de tous ordres en infraction avec le respect de la Constitution. Aucun recours n'est possible car, en l'occurrence, ces juridictions appliquent la législation en vigueur.
Comme aux États-Unis, un citoyen doit pouvoir saisir le Conseil constitutionnel lorsqu'il y a contradiction entre l'application d'une disposition législative et le respect de la Constitution.
De surcroît, il serait hautement souhaitable qu'une révision complète de notre législation, en tous domaines, soit entreprise par ce même Conseil constitutionnel afin d'harmoniser notre droit avec la Constitution. Cela éviterait une foule de recours.
D'autre part, cette révision doit emporter le droit pour tout citoyen qui a été victime d'une décision passée « en force de chose jugée » d'en obtenir la réforme avec les conséquences qui en résultent.
Cette mesure devrait permettre d'améliorer efficacement les rapports entre l'État et les Français et contribuer à l'établissement d'une justice plus équitable et moins contestée."
Pour Valoriser la GMS, c'est aussi une société hors du chaos et du marasme, donc de ce qui est daloyal (Valeurs à respecter : 0MC FMI OMT ...) c'est l'objet de la crise financière etc .. donc Agir avec force en insistant sur le plan institutionnel avec une prévisionnel spécifique valorisant les institutions de la "démocratie moderne du développemnt durable" qui n'est pas tendre non plus mais suffisament évoluée et pragmatique, pour rester humains et correct avec toutes les parties prenantes ! donc les intarêts de la GMS !
et de respect pour les religions, les Croyants,laics et athés, et leurs conseillers utiles et avisés ! il n'y a pas d'opposition avec les institutions qui doivent évoluer certes mais le blog de MEL est aussi pour ça ! merci MEL.
Voici un exposé qui évoque les relations complexes de nos institutions qui au premier abord n'en ont aucune mais qui après étude en ont beaucoup avec des répercutions possibles pour des décisions lourdes.
Les relations entre le Conseil constitutionnel et les juridictions françaises et européennes
(exposé présenté lors de la visite au Conseil constitutionnel, en juillet 1998, de représentants de la Cour suprême américaine)
I) En première approximation, elles sont inexistantes
Les rapports que le Conseil constitutionnel entretient avec les juridictions françaises et européennes, ne peuvent être qu'informels et indirects et ce, pour deux raisons :
1) Dans l'ordre juridique français, le Conseil constitutionnel est le seul organe constitutionnel. Aucun autre n'a le pouvoir de juger la loi à l'aune de la Constitution.
Il n'existe pas non plus d'" exception d'inconstitutionnalité " en droit français. Aussi les juridictions de droit commun ne disposent-elles pas de la possibilité de déférer au Conseil constitutionnel une loi dont la constitutionnalité leur paraît douteuse et dont l'application est nécessaire à l'espèce dont elles se trouvent saisies. Cette possibilité existe pourtant en Allemagne, en Autriche, en Espagne ou en Italie (pays qu'inspire pleinement la conception kelsénienne du contrôle de constitutionnalité). Elle a failli être mise en place en France en 1993, mais le Parlement s'y est opposé.
La France occupe donc une place intermédiaire, en Europe, entre les systèmes kelséniens " de plein exercice ", où le juge constitutionnel peut connaître de la constitutionnalité d'une loi après sa promulgation, et les démocraties " légicentristes " dans lesquelles la loi échappe totalement au contrôle de constitutionnalité (Royaume Uni, Pays Bas, Suisse).
Si la loi peut faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité en France, c'est seulement dans le court intervalle du temps séparant son vote de sa promulgation et seulement à l'initiative des plus hautes autorités politiques (Chef d'Etat, Premier ministre, Présidents des deux Chambres et surtout, depuis la révision constitutionnelle de 1974, soixante députés ou soixante sénateurs).
Il n'existe donc pas de lien organique et moins encore hiérarchique entre le Conseil constitutionnel et les juridictions de droit commun (celles de l'ordre judiciaire, ayant à leur tête la Cour de cassation, et celles de l'ordre administratif, ayant à leur tête le Conseil d'Etat).
Le Conseil constitutionnel n'est pas une Cour suprême.
2) S'agissant maintenant de l'ordre juridique européen, le Conseil constitutionnel n'entretient non plus de relations organiques ni avec la Cour de justice des Communautés européennes , ni avec la Cour européenne des droits de l'homme.
Si l'ordre juridique constitutionnel national et l'ordre juridique européen ne sont évidemment pas indifférents l'un à l'autre, ils coexistent sans hiérarchie mutuelle, ni mécanisme de résolution de leurs éventuels conflits.
Au demeurant, la place respective de la norme européenne et de la norme constitutionnelle dans la hiérarchie des normes donne matière à débats. La norme européenne occupe dans l'ordre juridique interne une place sans doute infraconstitutionnelle et certainement supralégislative. En revanche, la norme européenne doit prévaloir dans l'ordre juridique communautaire sur toute norme nationale, fût-elle constitutionnelle (arrêt CEJ Costa c/Enel, 15 /07 /64). La contradiction éventuelle ne pourra donc être résorbée que par une révision constitutionnelle.
Par ailleurs, les normes européennes (à quelques exceptions près explicitées par la Constitution), comme de façon générale, les normes du droit international, ne sont pas des normes de référence pour le contrôle de constitutionnalité.
Qui plus est, lorsque le Conseil rencontre une question d'interprétation de la norme communautaire, il ne dispose pas de la possibilité de saisir la Cour européenne de Justice d'une question préjudicielle (ne serait-ce que pour des raisons pratiques liées au délai impératif et court qui lui est imparti pour statuer sur une loi dans le cadre du contrôle préventif et abstrait qui est le sien).
On peut le regretter, car ce pourrait être utile même si la norme communautaire n'est pas une norme de référence pour le contrôle de constitutionnalité : par exemple lorsque la portée de la norme communautaire permet de cerner une différence de situation juridique susceptible de justifier une différence de traitement et donc de statuer sur un grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité (l'hypothèse s'est réalisée à la fin de l'année 1997, à propos de la loi de financement de la sécurité sociale).
Enfin, les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au " procès équitable " ne s'appliquent pas aux procédures conduites devant le Conseil constitutionnel, même dans le contentieux électoral, comme la Cour de Strasbourg vient récemment de le juger (21 octobre 1997, Pierre-Bloch c/ France No 120/1996/732/938).
II) Un certain nombre d'éléments viennent toutefois tempérer cet isolement du Conseil constitutionnel
1) Dans l'ordre juridique interne, les jurisprudences du Conseil constitutionnel d'une part, de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat, d'autre part, s'influencent sans cesse.
a) Dans le sens de l'influence du Conseil constitutionnel sur la jurisprudence des juridictions de droit commun, il faut tout d'abord souligner qu'en vertu de la Constitution elle-même (article 62) "les décisions du Conseil constitutionnel..s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles". L'autorité de la chose jugée par le Conseil s'attache au dispositif de ces décisions et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. L'autorité de la chose décidée par le Conseil constitutionnel -il est important de le souligner- s'étend également aux éventuelles " réserves d'interprétation " dont elle est assortie. Lorsque de telles réserves comportent des " directives " à l'adresse du pouvoir réglementaire d'application des lois ou directement à celle du juge compétent, elles constituent évidemment des éléments de l'ordonnancement juridique dont les juridictions ordinaires tiendront compte le moment venu.
Au-delà du strict respect de l'article 62, la jurisprudence du Conseil constitutionnel exerce une profonde influence sur les juridictions de droit commun. Depuis le
développement du contrôle de constitutionnalité (révision constitutionnelle de 1974), peu de domaines n'ont pas été touchés par ce contrôle (du droit pénal au droit du travail, du droit de la communication au droit administratif.etc..). Cette " irrigation " du toutes les branches du droit par le droit constitutionnel, y compris de celles qui en étaient traditionnellement le plus éloignées (droit civil), a conduit une partie de la doctrine à évoquer un phénomène de constitutionnalisation du droit français.
En pratique, il est incontestable que les juridictions ordinaires s'inspirent de plus en plus de la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour confronter aux normes constitutionnelles les actes dont elles ont à apprécier la validité juridique (ainsi, pour la juridiction administrative, les actes réglementaires).
Encore faut-il que ces actes ne soient pas déterminés par une loi, car celle-ci ferait alors " écran " au contrôle de constitutionnalité par le juge ordinaire. Comme on l'a dit, le juge ordinaire est obligé d'appliquer la loi, quand bien même il la jugerait inconstitutionnelle. Sa seule ressource (en l'absence de décision du Conseil constitutionnel) est, face à une disposition législative tolérant plusieurs interprétations, d'écarter celles d'entre elles qui lui paraissent méconnaître une norme constitutionnelle.
Enfin, il va sans dire que l'influence la plus remarquable de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les juridictions ordinaires est celle qui porte sur leurs compétences, leur organisation ou le statut de leurs membres.
b) Réciproquement, la jurisprudence du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation influence celle du Conseil constitutionnel. L'exemple, le plus célèbre est celui de la liberté d'association, où le Conseil d'Etat avait vu en 1956, soit plusieurs années avant le Conseil constitutionnel dans sa célèbre décision de 1971, un des " principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ", mentionnés par le Préambule de la Constitution de 1946.
En outre, le Conseil constitutionnel attache le plus grand prix, lorsque cet avis est fondé sur des considérations constitutionnelles, à l'avis donné par les formations consultatives du Conseil d'Etat sur le projet de loi d'où est issue la loi sur laquelle il doit se prononcer.
2) Dans l'ordre juridique européen, le refus du Conseil constitutionnel, constamment réitéré depuis 1975, d'estimer qu'une loi contraire à un traité ou à un acte de droit communautaire dérivé est ipso facto inconstitutionnelle, malgré la suprématie des traités sur les lois proclamée par l'article 55 de la Constitution, est compensé par le devoir qu'a le juge ordinaire de faire prévaloir le traité sur la loi. Depuis le début des années 90, cette suprématie bénéficie au droit communautaire dérivé comme au droit communautaire originaire et notamment aux directives européennes non transposées si celles-ci sont suffisamment claires et inconditionnelles et que le délai de transposition est écoulé.
La suprématie, sur la loi, d'instruments internationaux tels la Convention européenne des droits de l'homme, lorsqu'ils sont invoqués devant le juge ordinaire, produit même, dans certains cas, des effets analogues à ceux d'une exception d'inconstitutionnalité. Je pense à l'application fréquente par les juridictions administratives, dans le domaine du droit des étrangers, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit à une vie familiale normale ; ou encore, dans celui des sanctions administratives, de l'article 6 de la même Convention, relatif aux règles du procès équitable.
Le juge ordinaire pratique ainsi un " contrôle de conventionnalité ", bien proche en vérité d'un contrôle de constitutionnalité direct, de type américain.
Le Conseil constitutionnel, de son côté, sans se référer expressément au Traité sur l'Union européenne ou à la Convention européenne des droits de l'homme a " constitutionnalisé " un certain nombre de droits issus de la construction européenne (il suffit de penser à la liberté de circulation et d'établissement, à l'égalité entre les sexes, au droit au recours juridictionnel, à la participation aux élections locales ou au droit à une vie familiale normale). Il est vrai qu'il a refusé d'en constitutionnaliser d'autres, faute de point d'ancrage suffisant dans le " bloc de constitutionnalité " national (principe de " confiance légitime ").
Réciproquement, ont été reconnus au niveau européen des droits et libertés fondamentaux communs aux divers Etats membres, soit spontanément par les cours de Luxembourg et de Strasbourg, soit par les Traités eux-mêmes. Il convient de citer
à cet égard, l'art. 6 § 2 du Traité sur l'Union européenne : " l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire ").
Intégration européenne et protection des droits fondamentaux ne se conçoivent donc plus l'une sans l'autre.
La complémentarité se manifeste également sur le plan fonctionnel, aussi longtemps du moins que les tâches de contrôle juridictionnel se répartiront de façon équilibrée.
Cet équilibre repose, semble-t-il, sur la division des rôles suivante :
- afin de garantir l'indispensable unité d'application du droit communautaire, le juge constitutionnel, à l'instar du juge ordinaire, s'en remet à la Cour européenne de justice pour ce qui est de l'interprétation et de la validité de la norme communautaire ;
- en contrepartie, la Cour de justice des Communautés européennes vérifie effectivement que cette norme, d'une part, respecte les droits fondamentaux, d'autre part, n'outrepasse pas les compétences transférées par les traités aux institutions européennes.
Au-delà de cette division des tâches, l'évolution des esprits, des textes et des jurisprudences, doit nous orienter vers des relations de coopération entre cours constitutionnelles nationales, Cour européenne de justice et Cour européenne des droits de l'homme.
C'est ainsi qu'un colloque a réuni ici même en septembre 1997 les représentants de la Cour de justice des Communautés européennes et ceux des cours constitutionnelles et des Cours suprêmes à compétence constitutionnelle des quinze pays membres de l'Union européenne sur les questions de conciliation entre droits constitutionnels nationaux et ordre juridique communautaire. Une remarquable convergence de vues s'est dégagée à l'occasion de ce colloque sur la " division des tâches " que j'évoquais il y a un instant.
Voilà un éclaircissement sur le fonctionnement de nos institutions.
Avez vous rencontré des difficultés de ce type dans d'autres pays ou cela caractérise-t-il l'exception culturelle française?
Que pensez vous de cette affirmation?
"Il faut étendre les pouvoirs
du Conseil Constitutionnel
En instituant le Conseil constitutionnel, le Général de Gaulle a inclus une disposition nouvelle. Tout laisse à penser qu'il a calqué cette idée sur la Constitution américaine.
Des perfectionnements y ont été apportés. C'est ainsi que sa saisine, qui était, au départ, réservée uniquement au Président de la République et aux Présidents des deux Assemblées, a été étendue aux parlementaires pour autant que cinquante d'entre eux le demandent.
Comme aux États-Unis, le Conseil constitutionnel est dépendant, pour une large part, du pouvoir puisque ses membres sont nommés par les Présidents de la République et des deux Assemblées. Nous avons constaté que ce mode de désignation ne présentait pas jusqu'à ce jour d'inconvénients majeurs en raison même de ce que les membres choisis pour siéger ont, pour la plupart, une compétence juridique incontestable.
Or, le Conseil constitutionnel ne peut intervenir que dans les cas limités, c'est-à-dire lorsqu'il est saisi avant la promulgation d'une loi votée par le Parlement.
Le droit français comporte malheureusement une foule de dispositions qui ne sont pas conformes à la Constitution. Toutes ces lois sont appliquées et personne ne peut invoquer leur nullité. Si l'on se réfère aux États-Unis, où la Cour suprême fait office de Conseil constitutionnel, l'on remarque que cet organisme est habilité à régler les différends opposant les citoyens à l'État fédéral.
Il importe que le Conseil constitutionnel puisse intervenir en pareil cas car il est intolérable qu'en l'absence d'une juridiction compétente, les citoyens soient victimes de dispositions anticonstitutionnelles.
Cette réforme ne nécessite pas d'importants changements juridiques mais elle s'impose dans un pays de droit dont la règle démocratique constitue la base même des rapports entre les citoyens et l'État.
Chaque jour des sentences sont rendues par les tribunaux de tous ordres en infraction avec le respect de la Constitution. Aucun recours n'est possible car, en l'occurrence, ces juridictions appliquent la législation en vigueur.
Comme aux États-Unis, un citoyen doit pouvoir saisir le Conseil constitutionnel lorsqu'il y a contradiction entre l'application d'une disposition législative et le respect de la Constitution.
De surcroît, il serait hautement souhaitable qu'une révision complète de notre législation, en tous domaines, soit entreprise par ce même Conseil constitutionnel afin d'harmoniser notre droit avec la Constitution. Cela éviterait une foule de recours.
D'autre part, cette révision doit emporter le droit pour tout citoyen qui a été victime d'une décision passée « en force de chose jugée » d'en obtenir la réforme avec les conséquences qui en résultent.
Cette mesure devrait permettre d'améliorer efficacement les rapports entre l'État et les Français et contribuer à l'établissement d'une justice plus équitable et moins contestée."
Pour Valoriser la GMS, c'est aussi une société hors du chaos et du marasme, donc de ce qui est daloyal (Valeurs à respecter : 0MC FMI OMT ...) c'est l'objet de la crise financière etc .. donc Agir avec force en insistant sur le plan institutionnel avec une prévisionnel spécifique valorisant les institutions de la "démocratie moderne du développemnt durable" qui n'est pas tendre non plus mais suffisament évoluée et pragmatique, pour rester humains et correct avec toutes les parties prenantes ! donc les intarêts de la GMS !
et de respect pour les religions, les Croyants,laics et athés, et leurs conseillers utiles et avisés ! il n'y a pas d'opposition avec les institutions qui doivent évoluer certes mais le blog de MEL est aussi pour ça ! merci MEL.
Voici un exposé qui évoque les relations complexes de nos institutions qui au premier abord n'en ont aucune mais qui après étude en ont beaucoup avec des répercutions possibles pour des décisions lourdes.
Les relations entre le Conseil constitutionnel et les juridictions françaises et européennes
(exposé présenté lors de la visite au Conseil constitutionnel, en juillet 1998, de représentants de la Cour suprême américaine)
I) En première approximation, elles sont inexistantes
Les rapports que le Conseil constitutionnel entretient avec les juridictions françaises et européennes, ne peuvent être qu'informels et indirects et ce, pour deux raisons :
1) Dans l'ordre juridique français, le Conseil constitutionnel est le seul organe constitutionnel. Aucun autre n'a le pouvoir de juger la loi à l'aune de la Constitution.
Il n'existe pas non plus d'" exception d'inconstitutionnalité " en droit français. Aussi les juridictions de droit commun ne disposent-elles pas de la possibilité de déférer au Conseil constitutionnel une loi dont la constitutionnalité leur paraît douteuse et dont l'application est nécessaire à l'espèce dont elles se trouvent saisies. Cette possibilité existe pourtant en Allemagne, en Autriche, en Espagne ou en Italie (pays qu'inspire pleinement la conception kelsénienne du contrôle de constitutionnalité). Elle a failli être mise en place en France en 1993, mais le Parlement s'y est opposé.
La France occupe donc une place intermédiaire, en Europe, entre les systèmes kelséniens " de plein exercice ", où le juge constitutionnel peut connaître de la constitutionnalité d'une loi après sa promulgation, et les démocraties " légicentristes " dans lesquelles la loi échappe totalement au contrôle de constitutionnalité (Royaume Uni, Pays Bas, Suisse).
Si la loi peut faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité en France, c'est seulement dans le court intervalle du temps séparant son vote de sa promulgation et seulement à l'initiative des plus hautes autorités politiques (Chef d'Etat, Premier ministre, Présidents des deux Chambres et surtout, depuis la révision constitutionnelle de 1974, soixante députés ou soixante sénateurs).
Il n'existe donc pas de lien organique et moins encore hiérarchique entre le Conseil constitutionnel et les juridictions de droit commun (celles de l'ordre judiciaire, ayant à leur tête la Cour de cassation, et celles de l'ordre administratif, ayant à leur tête le Conseil d'Etat).
Le Conseil constitutionnel n'est pas une Cour suprême.
2) S'agissant maintenant de l'ordre juridique européen, le Conseil constitutionnel n'entretient non plus de relations organiques ni avec la Cour de justice des Communautés européennes , ni avec la Cour européenne des droits de l'homme.
Si l'ordre juridique constitutionnel national et l'ordre juridique européen ne sont évidemment pas indifférents l'un à l'autre, ils coexistent sans hiérarchie mutuelle, ni mécanisme de résolution de leurs éventuels conflits.
Au demeurant, la place respective de la norme européenne et de la norme constitutionnelle dans la hiérarchie des normes donne matière à débats. La norme européenne occupe dans l'ordre juridique interne une place sans doute infraconstitutionnelle et certainement supralégislative. En revanche, la norme européenne doit prévaloir dans l'ordre juridique communautaire sur toute norme nationale, fût-elle constitutionnelle (arrêt CEJ Costa c/Enel, 15 /07 /64). La contradiction éventuelle ne pourra donc être résorbée que par une révision constitutionnelle.
Par ailleurs, les normes européennes (à quelques exceptions près explicitées par la Constitution), comme de façon générale, les normes du droit international, ne sont pas des normes de référence pour le contrôle de constitutionnalité.
Qui plus est, lorsque le Conseil rencontre une question d'interprétation de la norme communautaire, il ne dispose pas de la possibilité de saisir la Cour européenne de Justice d'une question préjudicielle (ne serait-ce que pour des raisons pratiques liées au délai impératif et court qui lui est imparti pour statuer sur une loi dans le cadre du contrôle préventif et abstrait qui est le sien).
On peut le regretter, car ce pourrait être utile même si la norme communautaire n'est pas une norme de référence pour le contrôle de constitutionnalité : par exemple lorsque la portée de la norme communautaire permet de cerner une différence de situation juridique susceptible de justifier une différence de traitement et donc de statuer sur un grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité (l'hypothèse s'est réalisée à la fin de l'année 1997, à propos de la loi de financement de la sécurité sociale).
Enfin, les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au " procès équitable " ne s'appliquent pas aux procédures conduites devant le Conseil constitutionnel, même dans le contentieux électoral, comme la Cour de Strasbourg vient récemment de le juger (21 octobre 1997, Pierre-Bloch c/ France No 120/1996/732/938).
II) Un certain nombre d'éléments viennent toutefois tempérer cet isolement du Conseil constitutionnel
1) Dans l'ordre juridique interne, les jurisprudences du Conseil constitutionnel d'une part, de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat, d'autre part, s'influencent sans cesse.
a) Dans le sens de l'influence du Conseil constitutionnel sur la jurisprudence des juridictions de droit commun, il faut tout d'abord souligner qu'en vertu de la Constitution elle-même (article 62) "les décisions du Conseil constitutionnel..s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles". L'autorité de la chose jugée par le Conseil s'attache au dispositif de ces décisions et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. L'autorité de la chose décidée par le Conseil constitutionnel -il est important de le souligner- s'étend également aux éventuelles " réserves d'interprétation " dont elle est assortie. Lorsque de telles réserves comportent des " directives " à l'adresse du pouvoir réglementaire d'application des lois ou directement à celle du juge compétent, elles constituent évidemment des éléments de l'ordonnancement juridique dont les juridictions ordinaires tiendront compte le moment venu.
Au-delà du strict respect de l'article 62, la jurisprudence du Conseil constitutionnel exerce une profonde influence sur les juridictions de droit commun. Depuis le
développement du contrôle de constitutionnalité (révision constitutionnelle de 1974), peu de domaines n'ont pas été touchés par ce contrôle (du droit pénal au droit du travail, du droit de la communication au droit administratif.etc..). Cette " irrigation " du toutes les branches du droit par le droit constitutionnel, y compris de celles qui en étaient traditionnellement le plus éloignées (droit civil), a conduit une partie de la doctrine à évoquer un phénomène de constitutionnalisation du droit français.
En pratique, il est incontestable que les juridictions ordinaires s'inspirent de plus en plus de la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour confronter aux normes constitutionnelles les actes dont elles ont à apprécier la validité juridique (ainsi, pour la juridiction administrative, les actes réglementaires).
Encore faut-il que ces actes ne soient pas déterminés par une loi, car celle-ci ferait alors " écran " au contrôle de constitutionnalité par le juge ordinaire. Comme on l'a dit, le juge ordinaire est obligé d'appliquer la loi, quand bien même il la jugerait inconstitutionnelle. Sa seule ressource (en l'absence de décision du Conseil constitutionnel) est, face à une disposition législative tolérant plusieurs interprétations, d'écarter celles d'entre elles qui lui paraissent méconnaître une norme constitutionnelle.
Enfin, il va sans dire que l'influence la plus remarquable de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les juridictions ordinaires est celle qui porte sur leurs compétences, leur organisation ou le statut de leurs membres.
b) Réciproquement, la jurisprudence du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation influence celle du Conseil constitutionnel. L'exemple, le plus célèbre est celui de la liberté d'association, où le Conseil d'Etat avait vu en 1956, soit plusieurs années avant le Conseil constitutionnel dans sa célèbre décision de 1971, un des " principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ", mentionnés par le Préambule de la Constitution de 1946.
En outre, le Conseil constitutionnel attache le plus grand prix, lorsque cet avis est fondé sur des considérations constitutionnelles, à l'avis donné par les formations consultatives du Conseil d'Etat sur le projet de loi d'où est issue la loi sur laquelle il doit se prononcer.
2) Dans l'ordre juridique européen, le refus du Conseil constitutionnel, constamment réitéré depuis 1975, d'estimer qu'une loi contraire à un traité ou à un acte de droit communautaire dérivé est ipso facto inconstitutionnelle, malgré la suprématie des traités sur les lois proclamée par l'article 55 de la Constitution, est compensé par le devoir qu'a le juge ordinaire de faire prévaloir le traité sur la loi. Depuis le début des années 90, cette suprématie bénéficie au droit communautaire dérivé comme au droit communautaire originaire et notamment aux directives européennes non transposées si celles-ci sont suffisamment claires et inconditionnelles et que le délai de transposition est écoulé.
La suprématie, sur la loi, d'instruments internationaux tels la Convention européenne des droits de l'homme, lorsqu'ils sont invoqués devant le juge ordinaire, produit même, dans certains cas, des effets analogues à ceux d'une exception d'inconstitutionnalité. Je pense à l'application fréquente par les juridictions administratives, dans le domaine du droit des étrangers, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit à une vie familiale normale ; ou encore, dans celui des sanctions administratives, de l'article 6 de la même Convention, relatif aux règles du procès équitable.
Le juge ordinaire pratique ainsi un " contrôle de conventionnalité ", bien proche en vérité d'un contrôle de constitutionnalité direct, de type américain.
Le Conseil constitutionnel, de son côté, sans se référer expressément au Traité sur l'Union européenne ou à la Convention européenne des droits de l'homme a " constitutionnalisé " un certain nombre de droits issus de la construction européenne (il suffit de penser à la liberté de circulation et d'établissement, à l'égalité entre les sexes, au droit au recours juridictionnel, à la participation aux élections locales ou au droit à une vie familiale normale). Il est vrai qu'il a refusé d'en constitutionnaliser d'autres, faute de point d'ancrage suffisant dans le " bloc de constitutionnalité " national (principe de " confiance légitime ").
Réciproquement, ont été reconnus au niveau européen des droits et libertés fondamentaux communs aux divers Etats membres, soit spontanément par les cours de Luxembourg et de Strasbourg, soit par les Traités eux-mêmes. Il convient de citer
à cet égard, l'art. 6 § 2 du Traité sur l'Union européenne : " l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire ").
Intégration européenne et protection des droits fondamentaux ne se conçoivent donc plus l'une sans l'autre.
La complémentarité se manifeste également sur le plan fonctionnel, aussi longtemps du moins que les tâches de contrôle juridictionnel se répartiront de façon équilibrée.
Cet équilibre repose, semble-t-il, sur la division des rôles suivante :
- afin de garantir l'indispensable unité d'application du droit communautaire, le juge constitutionnel, à l'instar du juge ordinaire, s'en remet à la Cour européenne de justice pour ce qui est de l'interprétation et de la validité de la norme communautaire ;
- en contrepartie, la Cour de justice des Communautés européennes vérifie effectivement que cette norme, d'une part, respecte les droits fondamentaux, d'autre part, n'outrepasse pas les compétences transférées par les traités aux institutions européennes.
Au-delà de cette division des tâches, l'évolution des esprits, des textes et des jurisprudences, doit nous orienter vers des relations de coopération entre cours constitutionnelles nationales, Cour européenne de justice et Cour européenne des droits de l'homme.
C'est ainsi qu'un colloque a réuni ici même en septembre 1997 les représentants de la Cour de justice des Communautés européennes et ceux des cours constitutionnelles et des Cours suprêmes à compétence constitutionnelle des quinze pays membres de l'Union européenne sur les questions de conciliation entre droits constitutionnels nationaux et ordre juridique communautaire. Une remarquable convergence de vues s'est dégagée à l'occasion de ce colloque sur la " division des tâches " que j'évoquais il y a un instant.